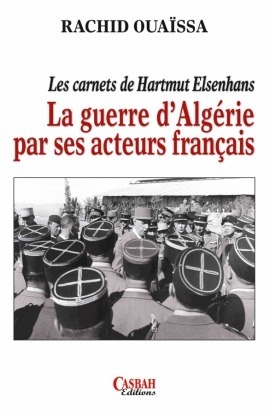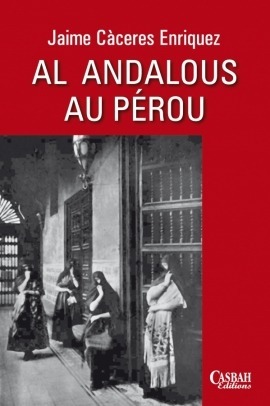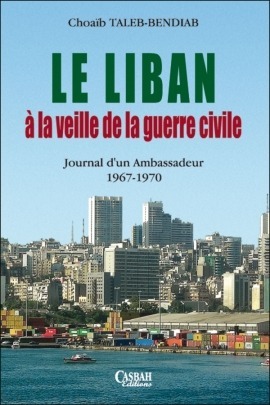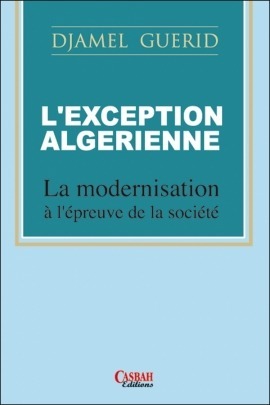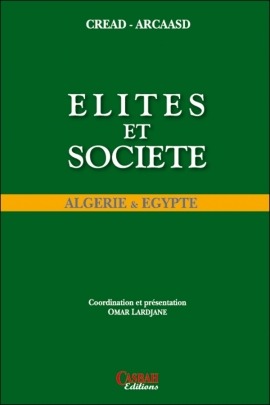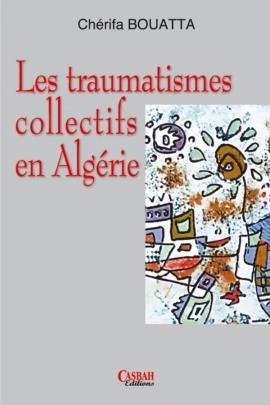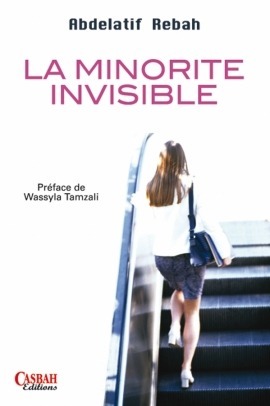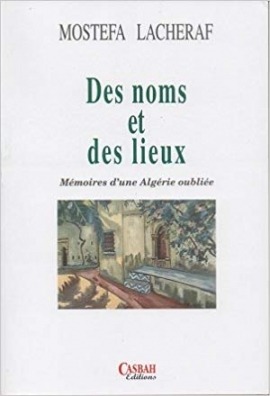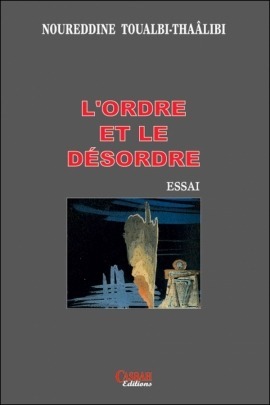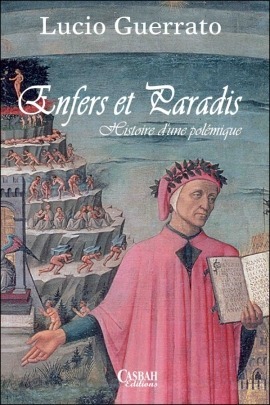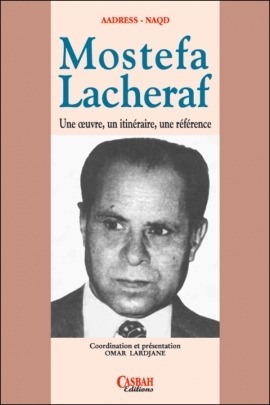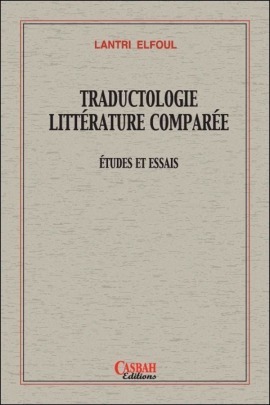Affichage de 133–144 sur 552 résultatsTrié par popularité
La guerre d’Algérie par ses acteurs français Les carnets de Hartmut Elsenhans – Rachid Ouaïssa
Un demi-siècle après le déclenchement de la guerre de libération algérienne, plus de quarante ans après sa fin, il est temps de mettre au service du grand public algérien et français et à celui des jeunes historiens et chercheurs des deux pays, qui verront peut-être aujourd’hui cette guerre d’un œil plus scientifique que militant, ces propos de quelques acteurs français importants d’une guerre qui fait encore débat.
Il s’agit ici d’interviews rares et inédites prises sur des bandes magnétiques que j’ai trouvé emballées dans la cave de la maison de M. le professeur Hartmut Elsenhans à Leipzig en Allemagne. Ces interviews ont été réalisées entre 1968 et 1972 à Paris avec de nombreuses personnalités françaises de presque tous les secteurs de l’État, civils et militaires, ainsi que des intellectuels et des responsables de la société civile…
Il est vrai que, contrairement à ce qui a été écrit sur cette guerre, le livre d’Elsenhans est « froid », vidé de tout sentiment. Ni haine, ni amour, ni sentiment de réconciliation, ni celui de la revanche, ne viennent affecter l’analyse scientifique des faits historiques.
Mais l’ouvrage a donné à cette guerre une place de choix parmi les grandes guerres en la plaçant dans le cadre des grands enjeux internationaux et dans celui des contradictions du système mondial et des rapports de forces entre l’Est et l’Ouest, entre le Sud et le Nord.
Entretiens avec : Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, Alain Krivine, Robert Lacoste, Max Lejeune, Guy Mollet, Georges Bidault, Jean-Marie Le Pen.
Al Andalous au Pérou – Jaime Càceres Enriquez
Né en 1934, à Lima, Jaime Càceres Enriquez s’est d’abord lancé dans des études littéraires à l’université nationale de San Marco avant de se tourner vers les sciences juridiques et politiques. Diplômé de l’université Federico Villareal, il entre dans la diplomatie en 1957. En poste successivement en Angleterre, à l’ONU, au Venezuela, auprès d’organisations internationales à Genève, il est nommé, en 1975, ministre plénipotentiaire à l’ambassade du Pérou en France. En 1980, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou en Algérie.
Parallèlement à sa carrière diplomatique, Jaime Càceres Enriquez a conduit une recherche passionnée et méthodique sur la présence des Morisques dans les colonies espagnoles d’Amérique. Exposés lors de nombreuses rencontres internationales ou publiés dans des revues, les résultats de ces travaux lèvent le voile sur une réalité peu connue du grand public.
Jaime Càceres Enriquez est décédé à Palma de Majorque en 1998.
À grands coups d’ordonnances, de lois et dispositions diverses, la Couronne espagnole s’employa, dès le premier voyage de Christophe Colomb et jusqu’à l’institution de l’Inquisition, à empêcher les
Morisques restés dans le royaume après la reconquista de gagner le Nouveau monde et d’y répandre la religion et la culture musulmanes.
Cependant, malgré sa rigueur, le dispositif mis en place ne fut pas hermétique.
Parmi les travaux qui établissent que, sous des noms d’emprunt et après une conversion de circonstance au christianisme, nombreux furent les morisques, femmes et hommes, à rejoindre les territoires nouvellement conquis des Amériques et à s’y installer, figurent en bonne place les études et recherches de Jaime Càceres Enriquez.
On apprend ainsi que les effets de la culture et des traditions d’Al Andalous sur le développement de la civilisation ibérique au Pérou se traduisent dans plusieurs domaines d’activité, attestés par des œuvres et des signes que l’on peut observer encore aujourd’hui.
Le Liban à la veille de la guerre civile – Choaïb Taleb-Bendiab
En 1967 les contradictions entre pays arabes s’accentuent : l’Arabie saoudite du roi Fayçal manifeste de plus en plus sa présence dans la région, répondant à la popularité croissante du président Nasser ; la Syrie et l’Irak sont sous le pouvoir du parti Baath ; l’Égypte et l’Arabie saoudite s’opposent militairement au Yémen. Le monde arabe est plus divisé que jamais ; la Ligue des États Arabes est totalement impuissante ; la question du détroit de Tiran et le retrait des troupes de l’ONU des frontières égypto-israéliennes provoquent une grande inquiétude en Israël : c’est la guerre des « six jours » et l’effondrement des armées égyptiennes et jordaniennes suivi des syriennes. Au refus qui caractérisait la politique arabe fait suite le refus israélien. Nasser et Hussein s’engagent dans la recherche d’une solution politique en s’adressant, avec l’appui des Soviétiques, au Conseil de sécurité de l’ONU qui finit par adopter la résolution 242, le 22 novembre 1967. Celle-ci ne fait pas l’unanimité des pays arabes et accentue encore davantage leur division. Résurgence du nationalisme palestinien, émergence des mouvements de résistance palestinienne et volonté de se dégager de la tutelle des pays arabes, détermination de la résistance palestinienne de s’implanter dans les pays limitrophes d’Israël provoquant des agressions violentes des Israéliens, « septembre noir » en Jordanie et la guerre civile au Liban.
L’exception algérienne – La modernisation à l’épreuve de la société – Djamel Guerid
Au plus fort du terrorisme, en 1995, un collègue français qui ne connaît rien à l’Algérie, me demande : « Est-ce que tu peux m’expliquer, en deux mots, ce qui vous arrive. » En 1995 aussi, un collègue français qui lui, connaît bien l’Algérie, s’interroge, surpris : « Comment a-t-on pu en arriver là ? » Des années durant, les Algériens n’ont pas arrêté de se poser cette question et de se l’entendre poser au cours de leurs voyages en Occident et en Orient.
À cette interrogation, des réponses ont été, bien sûr, proposées mais toutes se sont focalisées, à chaque fois, sur une cause unique : ou la religion ou l’économie ou la politique. Toutes pèchent par une bévue capitale : la non prise en compte des conditions particulières qui ont été la base de la production de la société algérienne d’aujourd’hui à commencer par le fait colonial. Cette production apparaît comme une exception. C’est dans ces conditions qu’il convient de chercher la clef pour l’intelligence de « ce qui nous arrive ».
Élites et société – Algérie & Égypte – Ouvrage collectif
Près de quatre-vingt universitaires (égyptiens, tunisiens, français, anglais et algériens) ont participé au colloque « Élites et société dans le monde arabe - Les cas de l’Algérie et de l’Égypte », en mars 2002 à Timimoun, dans le sud algérien.
Le CREAD (Alger) et l’ARCAASD (Le Caire) ont mis au travail des chercheurs égyptiens et algériens autour d’un projet commun qui répondait à la conviction qu’une approche comparatiste peut fournir des enseignements très riches sur l’objet d’étude. D’autant qu’en la circonstance, une ressemblance étonnante avait été notée par plusieurs observateurs, entre les processus sociopolitiques vécus par ces deux pays au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
On est même allé jusqu’à voir dans les évolutions générales de l’Algérie comme des répétitions, à dix années de distance, des évolutions traversées par l’Égypte.
Dans ce contexte, s’intéresser aux élites tient à une raison essentielle : la ressemblance constatée dans les évolutions sociopolitiques de l’Égypte et de l’Algérie ne tient-elle pas aussi à une ressemblance des caractères de leurs élites respectives, ou du moins des catégories d’élites ayant joué le rôle déterminant dans l’évolution de leur société au cours du dernier demi siècle? Nous pensons ici, bien sûr, aux élites militaires, mais aussi aux élites politiques,
technocratiques et aux élites religieuses.
Les actes du colloque présentent vingt-sept communications qui tentent de répondre à ces questionnements.
Les traumatismes collectifs en Algérie – Chérifa Bouatta
Les traumatismes dont nous avons essayé de rendre compte ne relèvent pas du registre historico-génétique mais de traumatismes dans la psyché et la culture. Ils ont été collectifs ; ils ont concerné les attaques des liens intersubjectifs qui lient une communauté et qui signent le entre-soi. Ces traumatismes ont ainsi rompu le contrat narcissique qui instaure et organise le vivre ensemble. Il s’agit de violences sociales et systématiques qui avaient des objectifs politiques et symboliques.
La minorité invisible – Abdelatif Rebah
« Les femmes entreprises » aurait-il fallu appeler ce livre, tant il ouvre sur une question vaste et difficilement réductible à l’économie et aux femmes. En effet, en soi, c’est déjà une révolution, aussi peu nombreuses soient les femmes entrepreneurs. Nous avons beau tirer à nous l’exemple de Khadidja la commerçante, la première femme du Prophète, la présence de femmes dans le domaine économique public reste une rupture de notre ordre social.
« Il faut rendre hommage au travail minutieux de l’auteur qui avec talent, et dans une très belle langue nous montre les lignes du changement dont on sait que par définition il est lent et infinitésimal, et surtout aux femmes “entrepreneurs” qui sont très certainement en train de construire une nouvelle image de la femme algérienne. Une nouvelle identité de la femme algérienne. »
Wassyla Tamzali (Extrait de la préface).
Des noms et des lieux – Mostefa Lacheraf
Mémoires d’une Algérie oubliée (Deuxième édition revue et augmentée)
Ces mémoires du professeur Mostefa Lacheraf restituent l’itinéraire d’un homme à qui un effort constant et soutenu a permis de devenir un intellectuel de premier plan. Davantage encore, ils proposent des repères extrêmement précis sur plus d’un demi-siècle d’histoire de l’Algérie.
Au-delà de l’autobiographie, il y a un témoignage, une analyse et une réflexion sur une société, une histoire, une culture, un enracinement civilisationnel. Cet ouvrage recèle une somme impressionnante d’informations qui en font une contribution majeure à la connaissance de l’Algérie.
L’ordre et le désordre – Noureddine Toualbi-Thaâlibi
La question fondamentale – je devrais même dire lancinante – qui, en réalité, fait le prétexte théorique de ce livre est celle de savoir pourquoi l’Algérie, dont on dit qu’elle est aujourd’hui riche de plus de 50 milliards de dollars de réserves de change et qui s’enorgueillit d’être une nation chargée d’une histoire dense et plurielle, ne parvient toujours pas, quarante années après son indépendance nationale, à “décoller” économiquement, à se structurer sociologiquement et à s’organiser politiquement. Par delà les points de vue traditionnels, économiques et politiques envisagés à la question et que résume aujourd’hui l’argument simiesque de la “mauvaise gouvernance”, se peut-il que le véritable motif de cet immobilisme socio-économique et culturel ou de cette “transition bloquée” comme disent les sociologues, soit à rechercher ailleurs qu’à travers ces thèmes conventionnels ?…
[Extrait de l’introduction]
Enfers et paradis – Histoire d’une polémique – Lucio Guerrato
Le 19 décembre 1919, le grand arabisant espagnol don Asin Palacios, lors de son discours de réception à l’Académie royale, choque l’auditoire en affirmant que Dante Alighieri, l’auteur de La Divine Comédie, non seulement se serait inspiré du Mi’radj et de l’Isra, mais aurait transposé dans son poème, le plus grand de la chrétienté, images, épisodes et symboles tirés directement de textes arabes écrits cinq siècles auparavant. C’est un véritable brûlot qui vient d’être lancé. La polémique fait rage et pendant plusieurs années les partisans de l’une et l’autre thèses bataillent sans quartier. Au moment où le débat semble s’éteindre sans vainqueurs ni vaincus, coup de théâtre !, apparaît un nouveau document qui relance l’affaire.
Lucio Guerrato narre les développements de cette controverse qui dure depuis un siècle, transformant un débat entre érudits en une sorte d’enquête judiciaire à rebondissements. Cela lui donne aussi l’occasion d’évoquer des mythes millénaires de l’outre-tombe, le climat culturel de l’époque de Dante, les échanges entre le monde arabe et le monde chrétien. La réponse finale qu’il propose à la question clef de cette affaire, “qui a copié qui ?”, n’est pas sans surprise.
Une œuvre, un itinéraire, une référence – Ouvrage collectif
L’œuvre écrite de Mostefa Lacheraf mérite pour être bien lue d’être mise en perspective spatio-temporelle. Pour trois raisons essentielles, en sus du fait qu’il s’agit d’un auteur ayant une conscience aiguë du moment historique, conscience insérée elle-même dans une véritable passion pour l’histoire.
La première raison tient à ce que Lacheraf est un personnage que l’actualité politique, depuis « l’incident » d’octobre 1956, a chargé d’une dimension historique exceptionnelle et qui, par la suite, s’est trouvé souvent aux premiers rangs du débat d’idées, voire de la polémique, même si cela fut épisodique et dans une relative discrétion de sa part. Mais l’homme public, militant et dirigeant politique ou idéologue, a une certaine image, formée dans les moments où l’actualité a braqué ses feux sur lui, qui imprègne et déforme parfois la lecture de ses textes.
La deuxième raison tient à ce que les écrits de Lacheraf ne sont pas tous des textes de doctrine ou de combat idéologique ou d’analyses historiques et sociologiques. Tout un pan de sa production, de critique et de préfacier notamment, concerne la littérature, le roman comme la poésie, le cinéma comme le théâtre, les arts populaires dans leurs diverses manifestations.
Il y a enfin l’homme privé en lui. Et s’il n’a pu malheureusement, en raison surtout des nécessités du combat national, prolonger et faire aboutir ses premiers écrits et ses premiers élans pour la poésie et le roman en lesquels il aurait livré son moi intérieur, cet homme se révèle d’une texture étonnante : lecteur invétéré, dans les deux langues française et arabe, amoureux des livres et de leur histoire, il continue à travers eux un soliloque intérieur d’une richesse humaine rare dont seuls ses récents Mémoires d’une Algérie oubliée ont pu révéler au grand public l’enracinement tellurique et la portée culturelle.
Traductologie littérature comparée – Lantri Elfoul
Pratique universelle et vieille comme les langues (Babel) parce qu’elle a répondu aux besoins du commerce des marchandises puis des idées, indispensable aux voyageurs puis aux conquérants, aux diplomates, aux politiques, aux stratèges, aux propagateurs de religions, puis à tous les curieux, les chercheurs, les écrivains, les savants, les artistes, la traduction resta essentiellement un art avant les tentatives modernes (XXe siècle) d’en faire une science spécialisée et sanctionnée par des diplômes, y compris en Algérie dès l’indépendance, non sans donner lieu à des divergences tant en ce qui concerne sa théorie que sa pratique et la pédagogie à mettre en oeuvre dans son enseignement. Ainsi est née la « traductologie », discipline qui se veut, par définition, autonome, mais indissolublement liée à toutes les sciences humaines… et même aux sciences exactes.
C’est donc un domaine situé au carrefour de toutes les disciplines qui se consacrent à l’étude des échanges entre les hommes, les peuples et les cultures et en particulier, au XXe s., à la littérature comparée et sa branche maîtresse: l’« imagologie » ou étude des images de l’étranger.
Les sept études regroupées dans cet ouvrage, outre la plus importante consacrée au(x) problème(s) de la traduction du Coran, traitent de la situation de la traduction en Algérie et de son enseignement, de la stylistique comparée de l’arabe et du français et des problèmes généraux de la traduction entre l’arabe et le français, ainsi que des problèmes et méthodes de
la littérature comparée et des frontières/transitions entre la création littéraire et les diverses formes de la traduction.