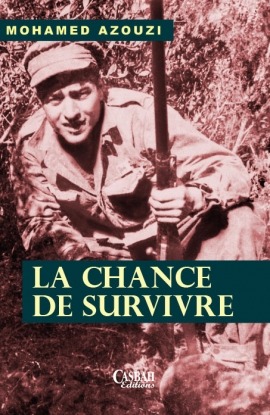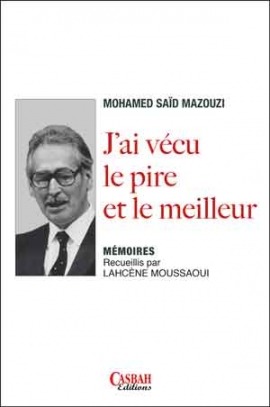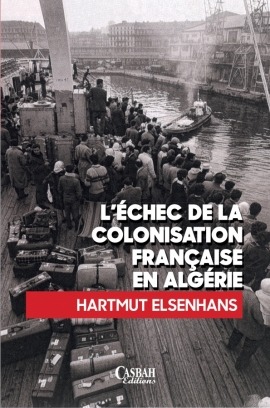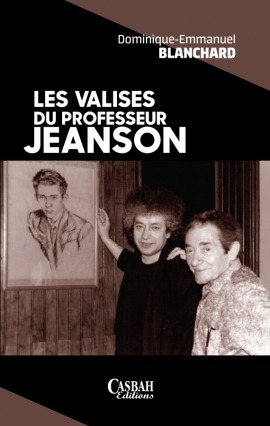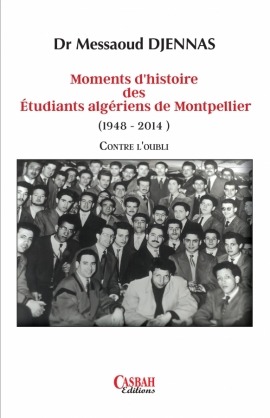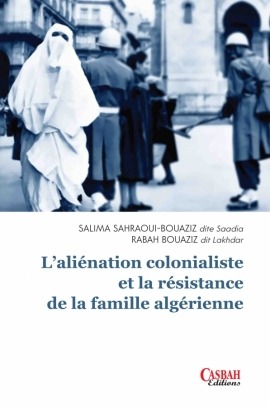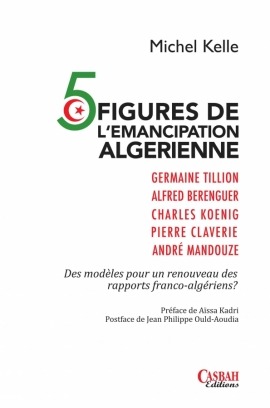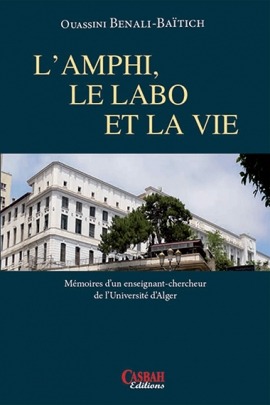Affichage de 193–204 sur 552 résultatsTrié par popularité
la chance de survivre – Mohamed Azouzi
Ancien cadre supérieur de la nation aujourd’hui à la retraite, Mohamed Azouzi était contrôleur des impôts directs dans l’administration française. A l’indépendance, il a été chargé de la direction régionale des impôts directs de l’Oranie, poste qu’il a occupé jusqu’en 1970. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la tête de la sous-direction de la législation fiscale et du contentieux national des impôts au ministère des Finances jusqu’à son admission à la retraite le 1er septembre 1980. Militant dès son jeune âge au sein de l’organisation clandestine de la lutte de libération nationale, l’auteur a rejoint le FLN après avoir appartenu au PPA puis à l’OS, ce qui lui a valu d’être arrêté et emprisonné par les autorités coloniales avant de reprendre le combat jusqu’au recouvrement de l’indépendance nationale. Ce sont les péripéties de ce parcours qu’à l’âge de 89 ans il retrace dans cet ouvrage-témoignage destiné aux jeunes lecteurs.
L’Algérie par ses archives – Du royaume de Tihert à la colonisation (VIIIe-XXe siècles) – Saïda Benchikh-Boulanouar
L’Algérie par ses archives c’est l’histoire contextualisée des institutions productrices d’archives du VIIIe au XXe siècle. Si la période coloniale et ses impacts sont encore à ce jour, insuffisamment explorés, les périodes historiques qui la précédent sont lacunaires. Comment s’est constitué le premier royaume musulman en Algérie ? Quelles sont les dynasties de la Berbérie musulmane ? Quelles traces ont-elles laissé ? Comment la famine a pu s’abattre sur l’Algérie qui produisait et livrait son blé à Istanbul comme à la France ? Comment les épidémies ont pu décimer des tribus entières ? Comment la médecine traditionnelle, la culture algérienne a-t-elle affronté la culture coloniale ? Quel était le niveau d’instruction des algériens avant la colonisation ? Le XIXe siècle nous a-t-il apporté la connaissance ? Quelles relations l’Algérie entretenait-elle avec le reste du monde ?
La construction des savoirs est un enjeu à dimension multiple et aujourd’hui plus que jamais l’accès aux archives est une question pertinente pour les historiens et pour les citoyens qui désirent connaître leur histoire. Si nos connaissances s’appuient sur nos archives, elles contribuent à combler des vides, à mettre des mots sur des évènements ignorés, à reconstituer une mémoire collective algérienne plus complète et à reconsidérer notre histoire et notre patrimoine historique à sa juste valeur.
L’Algérie par ses archives permettra sans doute de nouvelles lectures, de nouvelles écritures et leur transmission aux jeunes générations.
Saïda Benchikh-Boulanouar est chercheure en histoire de l’écrit et enseignante universitaire. Elle a obtenu son doctorat à l’Ecole pratique des hautes études, Paris-Sorbonne. Ses travaux sont spécialisés en historiographie maghrébine et ses sources. Elle est également Expert-Conseil en archivistique et milite pour la préservation du patrimoine historique.
J’ai vécu le pire et le meilleur – Mohand Saïd Mazouzi
« La dernière mission de ma génération est de dire aux jeunes d’aujourd’hui ce que nous avons vécu, simplement. Il ne s’agit pas tant de nos petites histoires individuelles, somme toute sans importance, mais de ce que ce peuple a subi, de ce qu’il a sacrifié et enduré pour que l’Algérie continue à exister.
La suite, c’est à eux de la faire, c’est à eux de l’écrire. À chaque génération sa Révolution ou son œuvre, ses défis à relever (...).
« (...) Dans l’Algérie du temps de l’ignorance et de l’analphabétisme imposés et d’école interdite aux indigènes, combien de nos concitoyens ont pu croire qu’arrivêlait le jour où l’enseignement généralisé serait accessible pour tous et même obligatoire ?
Qui ou combien pouvaient espérer au temps de l’Algérie des gourbis, qu’un jour les Algériens indépendants habiteraient des villas et des immeubles modernes ?»
L’échec de la colonisation française en algérie – Hartmut Elsenhans
« ... L’auteur apparaît comme un sympathisant de la cause anticolonialiste, et en même temps comme un ami et un admirateur de la France des droits de l’homme.
(...) Son immense mérite a été de rassembler et d’étudier, avec une exceptionnelle capacité d’analyse et de synthèse, une documentation d’une ampleur inimaginable pour un seul homme. Et aussi de démontrer
par son exemple la possibilité et l’intérêt de ce qu’on appelle « l’histoire immédiate », qui repose en grande partie sur des sources journalistiques sans se confondre avec le journalisme. Si sa documentation est aujourd’hui datée, la grande majorité de ses interprétations restent pleinement valables. Gilbert Meynier a eu raison d’écrire : « La France de Vichy a eu Paxton.
La guerre d’Algérie a désormais Elsenhans. Toute vision d’ensemble de la guerre d’Algérie ne pourra pas ne pas être marquée par la lecture d’un aussi grand livre d’histoire ... »
Guy Pervillé
Les valises du professeur Jeanson – Emmanuel Blanchard
À la fois biographie et essai, « Les Valises du professeur Jeanson » est aussi un récit qui peut se lire comme un roman.
Tout commence à l’hiver 1996, en France, dans une petite maison au bord du bassin d’Arcachon. Un inconnu, directeur d’une revue littéraire confidentielle vient, en vue d’un bref article, rencontrer Francis Jeanson qui a alors 74 ans. Commence une relation qui durera 15 ans…
Francis Jeanson, pourtant peu enclin à se souvenir, se raconte à l’auteur qui découvre qu’il ne savait pas grand-chose de cet homme « qui a été un proche de Sartre » et qu’il y a « du grain à moudre ».
Il est donc question de Sartre dans ce livre, mais aussi de Camus, de la guerre d’Algérie, du FLN, « des porteurs de valises » mais aussi, des femmes, de l’amour, du temps…
Puis, viendra le temps où Francis Jeanson, fatigué, malade, écrasé de douleur par la mort de celle qui a été sa compagne pendant un demi-siècle se battra pour survivre. L’auteur, pendant près de deux ans, passera le week-end seul avec lui dans la petite maison du Bassin. Ainsi le lecteur se trouve-t-il au coeur de l’intimité d’un intellectuel engagé qui a été, à l’époque de la guerre d’Algérie, l’un des hommes les plus recherchés de France par la police.
Le livre raconte aussi cela : cette lente et courageuse descente vers la mort d’un être que l’on ne pensait que croiser et qui, pour finir, devient un ami pour l’éternité.
Moments d’histoire des étudiants algériens de Montpellier ( 2014 – 1948) – Contre l’oubli – Messaoud Djennas
A l’instar des communautés estudiantines d’Alger, de Paris et d’ailleurs, celle de Montpellier ne tarda pas à s’engager massivement dans la lutte de libération nationale. Et là, il faut reconnaître que si l’UGEMA a constitué, dès sa création en juillet 1955, un temps fort dans l’engagement des étudiants, c’est
cependant, incontestablement, la grande grève du 19 Mai 1956, déclenchée par la section d’Alger, qui marqua de façon spectaculaire l’intégration de la jeunesse estudiantine algérienne dans les forces combattantes du FLN-ALN.
(Extrait de l’avant-propos)
L’aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne – Rabah Bouaziz
« J’espère que cet ouvrage « militant », écrit par deux patriotes pleinement engagés dans la lutte clandestine, saura encore intéresser des lectrices et lecteurs d’aujourd’hui et les aidera à mieux connaître et comprendre notre douloureux passé de colonisés, à travers quelques-unes des violations de notre personnalité, dont certaines séquelles transparaissent encore dans notre société actuelle. Qu’ils soient fiers aussi de leurs aînés(es) qui ont opposé depuis l’invasion des troupes françaises en 1830 une résistance farouche et sans répit à la violence coloniale, avant de passer résolument à la lutte armée dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1954, jusqu’à la victoire…..»
Aux origines de la médecine – El-Hadi Baba-Ali
Ce travail porte sur la constitution du savoir médical au long des civilisations mésopotamnienne, égyptienne, grecque, romaine, byzantine et arabo-musulmane.
L’apport des arabo-musulmans aux Européens dans la pose, à partir du XVIIème siècle, des pre-miers jalons de la médecine moderne, est, lorsqu’il est admis, relativisé par nombre d’historiens occidentaux...
Les informations rassemblées dans ce livre, destiné tant aux étudiants, aux professionnels de santé qu’au grand public, permettent d’avoir une autre vue sur une période importante de l’histoire le la médecine.
5 figures de l’émancipation algérienne – Michel Kelle
Cet ouvrage présente le parcours de cinq figures marquantes liées à l’histoire de l’Algérie du XXe siècle : deux Français de métropole, Germaine Tillion (1907-2007) et André Mandouze (1916-2006), et trois pieds noirs, Alfred Bérenguer (1915- 1996), Charles Koenig (1921-2009) et Pierre Claverie (1938-1996). Pourquoi ce choix ? Il permet de traverser l’histoire douloureuse de l’Algérie des années 1930 (apogée de l’époque coloniale avec la célébration du centenaire du débarquement de 1830) jusqu’aux trente
premières années mouvementées de l’indépendance, en passant par la période cruciale de la guerre de libération.
Dans des positionnements et des engagements différents dus à leur histoire
personnelle, faisant souvent preuve d’une clairvoyance prémonitoire, ces personnalités ont cherché, chacune à sa manière, à alerter les Européens d’Algérie et les Français de métropole sur les périls d’un système colonial fondamentalement injuste et sur l’urgence, après les événements
de 1945, à s’engager dans la voie de l’émancipation réclamée par le peuple algérien opprimé sur les plans politique, social, culturel et religieux. Attachés à la fois à la France et à l’Algérie, cette femme
et ces hommes ont voulu oeuvrer pour une paix juste et rapide et pour la cohabitation continuée d’une communauté européenne avec la population berbéro-arabe et musulmane d’une Algérie souveraine.
Mais leur engagement ne vaut pas seulement pour le XXe siècle. « Passeurs des deux rives », ils restent pour aujourd’hui et demain sans doute des modèles de volonté et de courage au service d’un dialogue «
à la recherche du vrai et du juste ». Leurs voix méritent de continuer à être entendues pour ouvrir aux deux peuples, algérien et français, la voie d’un renouveau de leurs relations, débarrassées des ressentiments du passé et tournées résolument vers un avenir de coopération et d’amitié nécessaires. C’est le message que cet ouvrage voudrait aussi transmettre aux générations nouvelles qui vivent sur nos deux sols.
Les cent batailles décisives de l’histoire – Salah Ould Moulaye Ahmed
L’histoire de l’humanité, depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours, est jalonnée de batailles, dont certaines eurent une telle importance historique qu’elles restèrent gravées dans la mémoire des hommes. Parmi ces affrontements, il en est d’une importance telle qu’ils ont scellé le destin des peuples et des nations et forgé la légende des grands hommes de guerre.
L’ouvrage expose dans un style clair, objectif et accessible à tous, un panorama large et varié d’une centaine de ces batailles décisives du passé où l’Histoire, retenant son souffle, a attendu le verdict des armes à défaut de celui de la raison et du droit.
L’auteur est un scientifique mais que les péripéties de son métier d’enseignant du supérieur ont conduit, des années durant, à donner des cours et des conférences scientifiques à des futurs officiers. D’où son penchant pour l’histoire militaire et son désir de le partager avec tout public intéressé ou avide de culture générale.
L’amphi, le labo et la vie – Ouassini Benali- Baitich
Cet ouvrage, fruit d’un travail de mémoire, relate le parcours d’un enseignant-chercheur de la faculté des sciences d’Alger à l’USTHB de Bab-Ezzouar, durant le cinquantenaire de sa carrière (1963-2013). Le récit, structuré de manière chronologique selon les périodes marquantes de l’histoire du pays et plus particulièrement de l’université, est entrecoupé par des réflexions sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, sur le métier enseignant-chercheur avec ses joies et ses servitudes, et même par de la fiction dans la description de portraits d’enseignants-chercheurs.
Une vie pour l’Algérie – Abdennour Chikh
Entré en résistance contre le colonialisme, comme maquisard, dès le début de l’année 1948, Amar Ath Chikh a été l’un des organisateurs du 1er Novembre 1954. Militant exemplaire, intègre, courageux et dénué de toute ambition personnelle, il contribua, par ses qualités morales et son abnégation, à approfondir la prise de conscience du fait national.C’est ainsi qu’il réussit à fédérer plusieurs actions politiques. On lui confia dès les premiers mois de la lutte armée, le commandement de la Zone VI dans la future Wilaya III.
En cette période du cinquantenaire de l’Indépendance de notre pays, cet ouvrage apporte un témoignage des proches parents de Amar Ath Chikh et constitue une modeste contribution à la connaissance de l’histoire des moudjahidine de l’Algérie combattante.
Les faits sont relatés avec la plus grande fidélité possible.